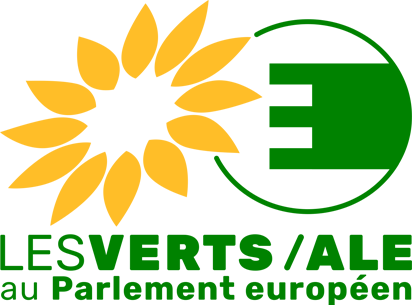Quelles priorités économiques européennes pour la France ?
Pascal Canfin, député européen Europe Ecologie-Les Verts
Dès les premiers jours de son mandat, le président de la République (et je me place ici dans la perspective d’un nouveau résident à l’Elysée !) devra prendre des décisions cruciales pour l’avenir de la politique européenne de la France. Le 25 mai aura lieu un conseil européen informel qui sera le premier rendez-vous du nouveau Président sur la scène européenne. Et le règlement qui pourrait donner force de loi à la « règle d’or » budgétaire sera dès le mois de mai sur la table des négociations entre le Conseil et le Parlement européen, qui l’auront d’ici là voté chacun de leur coté. Enfin, le Bundestag se prononcera probablement sur la ratification du traité « Merkozy » sur la stabilité budgétaire courant juin. Les échéances seront donc très rapprochées. Raison de plus pour les aborder à l’aune d’une réflexion stratégique sur la gouvernance économique de la zone euro, sur les priorités nouvelles que pourraient porter la France, et sur les termes d’un compromis acceptable pour l’Allemagne [1].
Quelle politique économique en Europe ?
Les politiques menées aujourd’hui par les gouvernements européens, dont une très large majorité d’entre eux sont dirigés par des conservateurs et des libéraux, reposent exclusivement sur un renforcement de la discipline budgétaire. L’analyse dominante est que les déficits publics sont devenus insoutenables, soumettent les Etats au bon vouloir des marchés financiers, et que le retour de la confiance nécessaire à la croissance repose sur des engagements stricts vers un chemin très ambitieux de réduction des déficits et des dettes publics. Pourtant, il est largement permis de douter que le niveau des déficits publics soit la cause principale des problèmes rencontrés depuis deux ans par la zone euro.
La dette publique moyenne de la zone euro est inférieure à celle des Etats Unis. Et des pays qui respectaient parfaitement les critères du pacte de stabilité sur les déficits et la dette publique, comme l’Espagne ou l’Irlande, ont vu leur modèle de croissance fondée sur des bulles immobilières et bancaires imploser en 2008 lors du retournement de la conjoncture économique. Enfin, dans la plupart des pays de la zone euro, les déséquilibres des finances publiques sont la conséquence des politiques de relance et de sauvetage des banques entreprises en 2008 et 2009, et des baisses d’impôts massives accordées pour l’essentiel aux plus riches et aux grandes entreprises. Ainsi, le taux officiel d’impôt sur les sociétés des pays de la zone euro a en moyenne baissé de 10 points entre 2000 et 2010, sous l’effet de la concurrence fiscale. Si le redressement financier des Etats doit bien sûr être un objectif de moyen terme, il ne peut être l’alpha et l’oméga de la politique économique européenne. D’autant que cette focalisation a pour conséquence d’emporter l’ensemble de la zone euro dans la récession. En effet, un pays peut réussir seul une cure d’austérité si ses voisins se portent bien : ce fut le cas par exemple de la Suède dans les années 1990. Mais il est, par construction, impossible de réussir une politique coordonnée d’austérité dans une zone économique aussi intégrée que la zone euro. Contrairement au socialisme, l’austérité n’est possible que dans un seul pays à la fois !
Des transferts financiers nécessaires
Il est donc impératif de mettre à l’agenda d’autres politiques qui répondent aux problématiques spécifiques de gouvernance de la zone euro. Contrairement aux Etats Unis, au Royaume Uni, au Japon ou à la Chine, les Etats de la zone euro ne peuvent pas être directement financés par la Banque centrale européenne (BCE). Cette spécificité ne repose pas d’abord sur une argumentation économique mais sur une vision politique qui refuse les transferts financiers entre les Etats et qui considère comme un aléa moral insupportable le sauvetage des Etats en difficulté. Une aide massive de la BCE à un Etat de la zone aurait pour conséquence de réaliser un transfert financier d’une entité fédérale vers une partie de la zone. Avec des conséquences qui pourraient potentiellement rétroagir négativement sur les autres pays au travers, par exemple, d’une inflation plus élevée pour tous les pays. Or, les Etats membres de la zone euro ont jusqu’à présent construit un consensus qui repose sur le moins de transferts financiers possibles entre Etats. Il n’existe toujours pas d’impôt européen ; le budget est toujours limité à 1 % du produit intérieur brut (PIB) européen, quand le budget fédéral américain s’élève à 25 % de la richesse du pays ; les fonds structurels ne représentent que moins de 0,4 % du PIB de l’Union ; et chaque politique européenne fait l’objet d’une négociation acharnée s’il doit en résulter des transferts financiers. Ainsi, selon les chiffres du sociologue Laurent Davezies, les transferts financiers entre régions françaises représentent dix fois les transferts financiers entre les pays européens. Sans ces transferts, le Limousin, par exemple, ne pourrait pas rester dans la même zone monétaire que l’Ile-de-France.
Mobilité du travail et maîtrise des déséquilibres extérieurs
Pour renforcer la zone euro, la priorité est donc d’instaurer des transferts financiers au niveau européen au travers par exemple d’une mutualisation partielle de la dette publique et du renforcement des ressources propres de l’Union. Mais ces transferts ne se mettront en place que progressivement. Il faut donc agir parallèlement sur deux autres leviers : la mobilité de la population européenne et la limitation ex ante des déséquilibres macroéconomiques.
Mobilité des hommes, d’abord. Certaines régions de la zone euro connaissent des taux de chômage très élevés, d’autres très faibles. Certains pays comme l’Allemagne ont une démographie décroissante. Il est donc naturel, comme ce fut le cas au XIXe siècle au sein des Etats-nations et jusque dans les années 1970 entre l’Europe du Sud et la France par exemple, que la mobilité se développe. Ainsi, des entreprises allemandes recrutent déjà en Espagne. Cette mobilité n’est bien sûr pas la panacée : le premier des droits est de pouvoir vivre et travailler là où on en a envie sans être obligé d’émigrer. Mais elle a un avantage politique : elle contribue à renforcer les liens entre les peuples européens. A condition qu’elle ne soit pas vue uniquement sous l’angle économique mais aussi comme un véritable projet politique. Et on ne peut que regretter que l’Europe ait renoncé à développer en son sein une langue commune, condition tellement importante pour que l’on puisse se comprendre et créer, au-delà du marché du travail, une société européenne. Car il est vain de penser que l’on pourra vraiment se comprendre sans parler la même langue.
Deuxième levier, la maîtrise des déséquilibres économiques. En effet, la meilleure façon de ne pas avoir à organiser des transferts financiers importants est encore de ne pas creuser les déséquilibres, c’est-à-dire des déficits… et des excédents excessifs. On touche ici au cœur de la contradiction interne à la vision « merkelienne » de la zone euro. Soit le gouvernement allemand accepte davantage de transferts financiers, soit il accepte de réduire ses excédents commerciaux sur ses partenaires européens. Mais il ne peut refuser les deux à la fois, sauf à mettre l’euro en péril. Sous la pression du Parlement européen, lors de la négociation sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance, l’Allemagne avait dû accepter que la Commission surveille de manière symétrique les excédents et les déficits, car ils sont de fait les deux faces d’une même médaille. Mais à peine l’encre du compromis avait elle séché que la Commission cédait sous une nouvelle pression du gouvernement Merkel et affirmait qu’elle regarderait d’abord les déficits et plus tard les excédents, et que le seuil à partir duquel un excédent commençait à poser problème était de 6 %, soit, comme par hasard, 0,1 point de plus que l’excédent allemand moyen ces trois dernières années…
On le voit, la feuille de route souhaitable pour redonner des couleurs à la zone euro va bien au-delà de l’application de la seule discipline budgétaire prônée par la droite européenne. Comment un gouvernement d’alternance en France peut-il contribuer à la rendre possible ? Et comment inscrire la stratégie française dans un nouveau « grand compromis » entre les Etats pour ouvrir une nouvelle ère de la construction européenne ?
Les termes d’un nouveau « grand compromis »
Investir dans l’économie verte pour l’emploi
Tout le monde s’accorde à le dire : il manque à l’Europe une stratégie d’investissement. Cela est vrai en Grèce comme pour l’ensemble de la zone euro. Mais définir une telle stratégie n’est pas chose facile, car encore faut-il se mettre d’accord sur les finalités et sur les moyens, aujourd’hui inexistants.
Il y a eu, dans les années 2000, un assez large consensus autour de ce qui était appelé à l’époque la Stratégie de Lisbonne, dont l’objectif était de bâtir l’économie la plus compétitive au monde. Avec deux leviers principaux : l’économie de la connaissance et des réformes structurelles pour libéraliser les économies, du marché du travail aux services publics. Cette stratégie n’impliquait pas d’investissements européens mais dessinait une feuille de route de réformes, d’inspiration social-libérale, destinée selon ses concepteurs à augmenter le potentiel de croissance de l’économie européenne. Cette stratégie a échoué, mais l’Europe n’en a pas de rechange.
Or, de plus en plus d’économistes s’accordent pour dire que la seule voie pertinente pour relancer l’économie est une relance verte [2]. L’Europe est le seul continent à importer aussi massivement son énergie. Les investissements destinés à économiser l’énergie sont donc bons pour l’emploi européen, bons pour notre balance extérieure et bons pour notre compétitivité. Ils sont également utiles pour notre indépendance géopolitique vis-à-vis des pays producteurs de gaz et de pétrole. Il s’agit donc d’un véritable intérêt général européen autour duquel pourraient s’accorder une majorité d’Etats, y compris l’Allemagne qui s’est elle-même donné des objectifs de réduction de gaz à effet de serre bien plus ambitieux que la France pour 2020. Cette stratégie est également valable en Grèce. Ce pays a l’une des plus faibles efficacités énergétiques de l’Union. Cela lui coûte chaque année une fortune en importation d’énergie. Il existe donc un gain potentiel très important si la Grèce se met enfin à utiliser ses propres ressources naturelles que sont l’ensoleillement exceptionnel et le vent.
Tout cela converge potentiellement pour rendre possible un accord sur les finalités et l’intérêt d’une stratégie d’investissements écologiques, au-delà des désaccords qui existent entre les Etats membres sur un sujet comme le nucléaire. Mais il manque aujourd’hui un pays, ou plutôt une coalition de pays, pour porter cette nouvelle stratégie. Il est évident que l’alternance en France en 2012 et en Allemagne en 2013, autour d’une alliance entre les sociaux-démocrates et les écologistes, est une condition politique essentielle pour faire advenir cette nouvelle orientation.
Mais une stratégie d’investissements demande des moyens. Où les trouver ? Les solutions techniques sont connues, il faut maintenant une avancée politique. Le premier outil sur lequel travaille la Commission sont les « obligations de projet » ou « project bonds ». Il s’agit d’émettre des obligations européennes sur les marchés pour financer des projets labellisés d’intérêt général européen et cofinancés notamment par la Banque européenne d’investissement (BEI). L’ingénierie devrait être en place courant 2012 et n’attend plus qu’un feu vert politique. Faire aboutir ces project bonds pour lever plusieurs centaines de milliards d’euros sur les marchés de façon à cofinancer des investissements verts, voilà qui pourrait être une des priorités du nouveau gouvernement français.
Deuxième outil, le budget européen. Jusqu’à présent, la France, comme les autres Etats, n’a pas poussé, c’est le moins que l’on puisse dire, en faveur d’un vrai budget européen financé par des ressources propres, c’est-à-dire par un impôt européen. La bataille ne sera pas facile mais chacun peut comprendre que si les Etats sont amenés à réduire leurs investissements, il est nécessaire qu’une « pompe européenne » puisse prendre le relais.
Troisième outil, les normes. Cela peut paraître étrange d’évoquer ce sujet dans une stratégie d’investissement mais le vrai pouvoir européen est d’abord un pouvoir normatif. C’est dans le cadre du marché unique que l’on peut instaurer des normes environnementales sur les produits ; c’est dans le cadre du code européen des marchés publics que l’on peut obliger les collectivités locales à mettre en place des critères environnementaux dans l’attribution de leurs marchés publics, etc. Or, qui dit normes d’accès au marché, dit investissements privés pour s’y conformer et pour innover. Ainsi, une politique ambitieuse de normes environnementales nourrit une relance verte en « obligeant » les entreprises qui veulent continuer à vendre sur le marché européen à investir dans de nouveaux moyens de production ou encore dans de nouveaux brevets. Et cela n’est pas contraire aux intérêts de l’industrie européenne puisque la contrainte porte aussi sur les concurrents extra-européens qui veulent vendre en Europe.
Sortir de la concurrence fiscale
L’Europe est aujourd’hui la zone au monde où la concurrence fiscale est la plus forte car nous avons à la fois un marché unique, qui permet une liberté totale de circulation des capitaux, tout en ayant 27 systèmes fiscaux concurrents. Une aubaine pour les multinationales. Et si les dossiers d’harmonisation fiscale avancent si lentement, ce n’est pas à cause des institutions européennes mais bien de la faute des Etats. Le Luxembourg et l’Autriche bloquent la fiscalité européenne sur l’épargne, l’Irlande, celle sur les bénéfices des sociétés, l’Italie, le fait de donner à la Commission le pouvoir de négocier avec les paradis fiscaux des règles communes, et le Royaume-Uni empêche l’adoption d’une taxe européenne sur les transactions financières. L’idée selon laquelle c’est le souverainisme des Etats qui serait protecteur quand l’Europe serait une menace est, en matière fiscale tout au moins, totalement fausse. Si les décisions fiscales ne relevaient plus de l’unanimité, nous aurions aujourd’hui un impôt unique sur les multinationales, des règles communes contre les paradis fiscaux, une taxe sur les transactions financières, etc., car la Commission et le Parlement y sont favorables.
Faire sauter ce point de blocage devrait être une priorité absolue de la France. Avec un argument : le manque à gagner pour les budgets des Etats que représentent l’optimisation et l’évasion fiscales. Selon la Commission européenne les seuls paradis fiscaux coûtent aux Etats 250 milliards d’euros par an. Impossible, dans ces conditions, d’opérer un redressement budgétaire réel et juste. La France pourrait trouver sur ce dossier un soutien en Allemagne, car une telle politique permet de rendre crédibles les plans de réduction des déficits souhaités notamment par ce pays. Le plan A est bien entendu de changer le traité de Lisbonne et de faire passer ces sujets en majorité qualifiée pour sortir des vétos nationaux. Le plan B serait de lancer avec les Etats volontaires des coopérations renforcées pour mettre en place une fiscalité commune sur les facteurs économiques mobiles (capitaux, transactions financières…) qui échappent aujourd’hui largement aux charges communes.
Créer un vrai gouvernement économique
Les règles qui régissent la zone euro doivent être revues pour assurer la pérennité de notre monnaie unique. L’Allemagne devra choisir entre accepter des transferts financiers (que ce soit sous la forme d’un budget européen ou sous forme d’obligations européennes) et accepter un droit de regard européen sur ses excédents, et donc sur sa politique salariale par exemple. La France, elle, ne pourra continuer à plaider pour un gouvernement économique sans accepter des vrais transferts de compétences et des transferts budgétaires au niveau européen. Elle devra également accepter des engagements de discipline budgétaire en contrepartie d’une politique de solidarité, de coopération fiscale et d’investissements européens.
Se dessinent ainsi les termes d’un nouveau grand compromis qui implique que chacun fasse un pas vers l’autre et analyse les contradictions de ses propres positions. Pour y parvenir, il faut des responsables politiques animés d’une vision et d’une ambition européennes. Et il faudra sortir de la politique des petits pas pour parvenir à un compromis général qui peut être proposé ensemble et dans les mêmes termes aux différentes opinions publiques européennes.
NOTES
[1] La relation avec l’Allemagne ne doit pas être l’unique axe diplomatique de la France, mais il est difficile d’imaginer construire une nouvelle stratégie européenne sans se poser la question des compromis vus d’Allemagne.
[2] Voir par exemple le dernier ouvrage de Michel Aglietta, Zone euro : éclatement ou fédération, Paris, Michalon, 2012.