
3 questions à Anna Iványi, militante pour les droits des femmes en Hongrie
Anna Iványi, chargée de relations internationales et de plaidoyer pour EMMA, association hongroise luttant pour les droits des femmes, travaillant en particulier sur l’oppression de genres et les violences pendant la période de grossesse et d’éducation des enfants.
Comment les droits des femmes ont évolué au cours des quinze dernières années en Hongrie, depuis l’arrivée au pouvoir de Viktor Orban ?
Comme le souligne un dernier rapport remis par des organisations hongroises sur les questions de droits des femmes au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la Hongrie est l’un des pays avec le backlash le plus important en matière d’égalité des genres et de droits des femmes. Les questions relatives aux femmes sont traitées presque exclusivement sous l’angle de la famille et les femmes sont représentées comme des mères et femmes au foyer.
Des changements institutionnels reflètent également cette relégation au second plan de l’égalité de genres et la réticence à traiter les droits des femmes en dehors du schéma des valeurs traditionnelles familiales. C’est en effet un vice-secrétaire d’État aux questions familiales qui est aujourd’hui chargé des droits des femmes, quand l’autorité sur l’égalité de traitement a cessé d’exister.
Les groupes marginalisés, notamment les femmes roms, les femmes avec un handicap ou les LGBTQIA+ ne sont pas pris en compte au niveau politique. La Convention d’Istanbul n’a par ailleurs pas été ratifiée, alors que 50% des femmes hongroises ont été sujettes à violence et abus de la part de leur partenaire.
En dépit d’un agenda gouvernemental pro-natalité, les services de maternité sont par ailleurs dans un état désastreux. Enfin, si l’avortement chirurgical est légal, il est soumis à plusieurs conditions notamment à l’écoute des battements de cœur du fœtus. Et l’avortement médicamenteux n’est lui, pas disponible.
Qu’attendez-vous des institutions de l’UE et des décideurs et décideuses politiques pour améliorer les droits des femmes en Hongrie et renforcer l’égalité femmes-hommes ?
Nous attendons que les préconisations de la résolution du Parlement européen de juin 2021 sur la situation des droits sexuels et reproductifs soient appliquées.
Il est également important que la Commission européenne adopte une recommandation sur la prévention des pratiques néfastes aux femmes et aux filles, en y incluant notamment des lignes directrices sur la manière de traiter les violences obstétriques et gynécologiques.
Nous souhaitons également que soit adoptée une stratégie sur la santé sexuelle et reproductive, qui contiendrait un réseau de surveillance sur la morbidité et mortalité maternelle. Cette stratégie devrait prendre en compte des situations spécifiques, comme les femmes roms, les femmes exilées, les femmes économiquement vulnérables, etc.
Enfin, il est primordial d’assurer des financements adéquats aux organisations de la société civile et aux défenseurs et défenseuses des droits humains actifs et actives sur les questions d’égalité de genres, de santé et de droits reproductifs et sexuels, de violence de genres ou encore de migrations et de personnes LGBTQIA+.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les femmes réfugiées, notamment les femmes réfugiées ukrainiennes de la communauté rom ?
Nous avons conduit des recherches à l’automne 2023, sur la base d’entretiens. Nous avons identifié plusieurs problèmes : l’intersectionnalité des discriminations (les femmes ukrainiennes roms font face à une multitude de discriminations), les barrières économiques (le manque de ressources financières), le manque d’informations sur les droits sexuels et reproductifs, le manque de traitements respectueux tenant compte des traumatismes.
Depuis la publication de ce rapport, il n’y a pas eu d’amélioration significative, ni de message politique positif. Par ailleurs, les réglementations sur le logement pour les réfugié·es sont de plus en plus strictes. Et par exemple, pour des personnes roms ayant la double nationalité ukrainienne et hongroise, elles ne sont plus assurées d’être traitées comme des personnes réfugiées. Ainsi, en août 2024, 3 000 à 4 000 personnes ont perdu leur logement, principalement des personnes de la communauté rom de Transcarpatie.

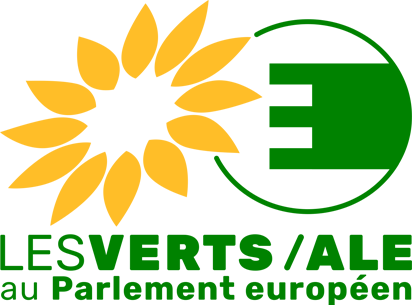
Les commentaires sont fermés.