
Budget 2025 : l’austérité en marche, les plus fragiles en ligne de mire
17 juillet 2025
En politique budgétaire, il existe une forme de prestidigitation qui consiste à agiter une idée absurde pour mieux faire passer des reculs bien réels. François Bayrou en a récemment offert un exemple caricatural.
En suggérant, avant de se raviser, de supprimer le jour férié du 8 mai pour faire des économies, il a réussi à concentrer l’attention sur un leurre, tout en validant l’agenda austéritaire d’un gouvernement qui ne dit pas son nom.
Car pendant que l’on ergote sur les jours fériés, la saignée budgétaire, elle, est bien réelle. Le projet de loi de finances 2025 prévoit une réduction drastique des dépenses publiques, ciblant d’abord les services, les droits sociaux et les salariés du public. En face, aucune remise en question des niches fiscales inefficaces, ni des largesses envers les secteurs les plus favorisés. Une austérité sélective, toujours dans le même sens.
1. Un budget sous contrainte… mais des choix assumés
Le gouvernement cherche à ramener le déficit public à 4,6 % du PIB en 2025, loin de la règle des 3 % théoriquement fixée par les traités européens. Mais ce chiffre est à mettre en perspective : le déficit était de 2,8 % en 2017 lorsque Macron est arrivé à l’Élysée. Le retour sous les 3 % n’est pas imminent, et les marges de manœuvre existent… pour peu qu’on les cherche du bon côté.
Selon l’Institut des Politiques Publiques, les réformes fiscales engagées depuis 2017 (suppression de l’ISF, flat tax, baisse de l’impôt sur les sociétés) ont représenté un manque à gagner annuel de plus de 15 milliards d’euros pour les finances publiques, avec un bénéfice concentré sur les 10 % les plus riches. Le Conseil d’Analyse Économique lui-même avait conclu en 2021 à une efficacité très limitée en matière d’investissement et de croissance.
2. Une année blanche pour les services publics et les plus modestes
Le cœur du budget 2025 repose sur ce que Bercy appelle une « année blanche » pour la dépense publique :
- Gel du point d’indice des fonctionnaires, c’est-à-dire un décrochage mécanique du pouvoir d’achat face à l’inflation.
- Non-remplacement de nombreux départs à la retraite : un agent public sur trois pourrait ne pas être remplacé dans certaines administrations, aggravant la situation déjà critique des hôpitaux, des écoles ou de la justice.
- Gel des prestations sociales : selon les premières annonces, les APL, la prime d’activité, les allocations familiales ou les pensions de certaines catégories ne seront pas revalorisées à hauteur de l’inflation en 2025. Une baisse de fait du niveau de vie des ménages les plus vulnérables.
Et pendant ce temps, les prix des médicaments devraient augmenter pour les patients, sous prétexte de « responsabilisation » des usagers. Mais où est la responsabilisation de l’État vis-à-vis de sa mission de protection sociale ?
3. Hôpital, école, climat : des services publics sous tension
Les signaux d’alerte sont partout :
- L’hôpital public connaît une fuite historique des soignants : près de 30 % des postes d’infirmiers vacants dans certains établissements (FHF, 2024), et une baisse continue des lits disponibles.
- L’Éducation nationale peine à recruter : les concours d’enseignants affichent des taux de postes non pourvus atteignant plus de 20 % dans certaines académies, et l’attractivité du métier est en chute libre.
- La transition écologique reste sous-financée : le Haut Conseil pour le Climat estime à 25 à 30 milliards d’euros par an le besoin de financement public pour atteindre les objectifs climatiques… bien loin des annonces gouvernementales.
Et pourtant, le projet de budget reste focalisé sur les coupes, comme si l’enjeu n’était plus de transformer la société mais de colmater à tout prix la ligne budgétaire. L’État se retire là où il est attendu, pendant qu’il continue de financer généreusement les intérêts privés.
4. Toujours plus pour le privé, toujours moins pour l’intérêt général
Prenons quelques exemples :
- Écoles privées : leur financement public a atteint près de 11 milliards d’euros par an, sans compter les niches fiscales pour les dons.
- Cliniques privées : bien qu’elles représentent moins de 40 % des capacités hospitalières, elles captent près de 50 % de certaines enveloppes de financement ciblé, souvent plus rentables.
- Concessions autoroutières : les dividendes versés aux actionnaires des sociétés d’autoroutes ont atteint 2,5 milliards d’euros en 2023, sans que l’État ne remette en question le modèle d’enrichissement privé à partir de l’investissement public initial.
5. Changer de cap, changer de route
À quoi bon mieux conduire une voiture si elle fonce dans le mur ? Voilà la question que pose ce moment politique. Ce n’est pas la conduite qu’il faut corriger, mais bien la direction.
Tant que le cap reste celui de la réduction du déficit sur le dos des plus précaires, de la rentabilisation des services publics, et de la complaisance vis-à-vis des détenteurs de capitaux, la colère montera, comme elle l’a fait avec les Gilets Jaunes, les soignants, les enseignants, ou plus récemment dans les mobilisations contre la réforme des retraites.
Un autre choix est possible : réorienter la fiscalité vers les hauts patrimoines et les rentes, investir massivement dans la transition écologique et les services publics, reconstruire un contrat social fondé sur la solidarité, la dignité et la justice.
Ce n’est pas le 8 mai qu’il faut supprimer : c’est le 49.3 permanent des dogmes néolibéraux qu’il faut renverser.
Mounir Satouri

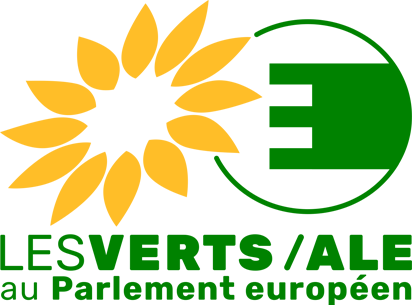
Les commentaires sont fermés.