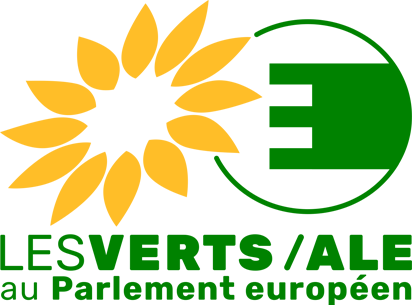Zone euro : une crise désormais politique
Premier temps de l’engrenage : les économies occidentales, l’Europe dans la foulée des USA, connaissent à la crise des « subprimes », cette économie à crédit qui permettait aux ménages, notamment américains, mais pas seulement, également européens, surtout en Espagne, dans les pays anglo-saxons et en Grèce, de vivre largement au dessus de leurs moyens, jusqu’à arriver à une incapacité collective de rembourser les sommes empruntées.
La fontaine de liquidités permise par les crédits accordés jusque là sans retenue par les banques, au nom du dogme productiviste du « il faut soutenir la croissance », se tarit soudain, aux USA d’abord, et en Europe immédiatement après, en raison de l’interpénétration croissante des économies occidentales, particulièrement dans le système bancaire.
Pour éviter l’effondrement des économies nationales, les États décident alors d’ouvrir à leur tour le robinet de l’argent en s’endettant massivement, en lieu et place des particuliers désormais largement insolvables. Chaque État lance alors son « programme de relance » ; on décide par exemple en France d’une extrêmement coûteuse « prime à la casse » automobile, et d’autres mesures de soutien à la consommation, on engage les communes à investir davantage, on renfloue les comptes des banques à coups de milliards d’euros pour chacune d’entre elles. En Irlande, le système bancaire est carrément nationalisé d’un trait de plume, ce qui laisse toute la charge de son renflouement aux contribuables, avec l’effondrement que l’on sait des comptes publics.
En Grèce, la situation est devenue rapidement critique car l’État était déjà très endetté quand la crise a commencé, endettement largement masqué par des statistiques frelatées complaisamment acceptées par la Commission Européenne de José Manuel Barroso au nom du respect de « l’indépendance » des États-membres. La dette publique grecque a ainsi atteint très vite des sommets qui rendent son remboursement problématique. D’où la crise de la dette souveraine, qui se traduit par une hausse vertigineuse des taux d’intérêts demandés pour continuer à prêter à l’État grec. Car la dette est pour les États une tension constante. Il leur faut régulièrement rembourser les prêts arrivant à échéance, et pour cela emprunter à nouveau au fur et à mesure, … et payer les intérêts demandés qui évoluent chaque fois à la hausse.
C’est là le nœud de la crise actuelle. Si les taux d’intérêt dérapent, les conséquences sont colossales. Pour refinancer sa dette qui est de 350 milliards d’euros, l’État grec doit dégager 3,5 milliards d’euros pour chaque un pour cent d’intérêt. Si au lieu d’emprunter à 2% comme l’Allemagne, le gouvernement grec emprunte à 5%, voire davantage, il lui faut débourser chaque année 10 à 11 milliards de plus d’intérêts pour une même somme empruntée. Pour bien comprendre ce que représente une telle somme, il suffit de réaliser que le dernier plan de rigueur pour la France présenté par François Fillon est du même montant estimé, 11 milliards d’euros, alors que la France est six fois plus peuplée que la Grèce et que son économie est en bien meilleure santé. L’État grec ne peut bien évidemment pas y faire face seul.
Pour éviter une situation de faillite, les mesures prises, difficilement, jusqu’ici ont consisté dans un premier temps à garantir les emprunts de la Grèce grâce au fonds de solidarité européen mis en place il y a quinze mois, fonds alimenté principalement par les « pays riches » de la zone euro, dont le leader incontesté est l’Allemagne. Ce mécanisme permet de libérer les sommes demandées pour apporter à l’État grec les moyens de renouveler ses emprunts et faire face ainsi à ses dépenses, salaires des fonctionnaires et toutes les dépenses indispensables pour éviter de sombrer dans le chaos Mais ce mécanisme n’agit pas, ou peu, sur les taux d’intérêt qui pèsent sur les finances de l’État, et la Grèce continue de s’enfoncer dans la crise.
La seule mesure que l’on peut envisager pour sortir de cette spirale serait que la dette grecque devienne tout simplement une « dette européenne » comme les autres, à un taux qui serait certes un peu supérieur aux 2% dont bénéficie actuellement la florissante économie allemande, mais sans dépasser les limites du supportable, probablement de l’ordre de 3%. De ce fait la charge de la dette grecque s’allégerait aussitôt de de 7 ou 8 milliards par an, bien plus que ce que pourrait rapporter un énième plan de réduction des dépenses dans un budget déjà rendu exsangue par la politique de rigueur imposée par le FMI et les pays contributeurs au plan de sauvetage de l’économie grecque.
Mais créer une « dette européenne » serait un pas en avant considérable dans le processus d’intégration européenne. Le fonds de solidarité créé l’an dernier consistait en fait à mener une « politique intergouvernementale », coordonnée à plusieurs, mais qui laissait à chaque État-membre le sentiment de maîtriser seul son destin. La mutualisation de la dette publique de l’ensemble de la zone euro – que prône notamment Éva Joly, candidate à l’élection présidentielle pour Europe Écologie les verts – conduirait mécaniquement à une solidarité de fait où certains perdraient – les Allemands et l’Europe du Nord en général- puisque le taux moyen européen serait obligatoirement plus élevé que les taux très bas dont ils bénéficient, quand les autres seraient soulagés par le recours à des emprunts à un taux beaucoup plus bas.
A court terme, les premiers ont largement les moyens de ce sacrifice, et c’est leur intérêt à long terme car le maintien d’une zone économique étendue de l’euro garantit l’activité de leurs entreprises qui, pour 70%, exportent dans le reste de l’Europe. Quant aux autres, c’est la seule solution possible pour desserrer l’étau des marchés et des taux d’intérêt, et espérer échapper à une faillite qui serait, politiquement et humainement, catastrophique.
Mais, pour cela, il faut surmonter les obstacles que constituent les États-nations en instituant un véritable fédéralisme européen. C’est le défi politique auquel l’Europe sera confrontée dans les semaines à venir.
François ALFONSI