
4e maraude – Gwendoline Delbos-Corfield : 48 heures aux confins de l’absurde
Équipée de chaussures de randonnée et d’affaires chaudes, prenant la suite de mes collègues Damien Carême, Benoît Biteau, Caroline Roose, Tilly Metz, je me suis rendue, du vendredi 19 février au dimanche 21 février, à la frontière franco-italienne de Montgenèvre à côté de Briançon.
Nous étions trois parlementaires : Claude Gruffat, également député européen, Guillaume Gontard, sénateur de l’Isère et président du groupe Écologiste – Solidarités et Territoire, et moi, accompagné·e·s de nos assistantes parlementaires, Anouk, Jessica et Mathilde. Nous étions aux côtés de Médecins du Monde et Tous Migrants qui maraudent pour porter assistance aux personnes exilées qui franchissent la frontière dans des conditions particulièrement dangereuses.
Le soir, dans Montgenèvre, désert après 18 heures, maraudeuses et maraudeurs et policières et policiers cherchent les exilé·e·s, mais pour des raisons différentes. Les un·e·s pour les mettre à l’abri, les autres pour les renvoyer le plus rapidement possible en Italie.
Alors, aux yeux du nouveau venu, se joue un sordide scénario de poursuite d’indiens et de cow-boys. Un jeu du chat et de la souris, absurde, sinistre et parfois violent. La police suit les maraudeurs, les maraudeurs circulent dans tout le village pour trouver les migrant·e·s.
Malgré cette présence policière oppressante, les maraudeurs s’arrêtent car ils tentent d’apercevoir des exilé·e·s en difficulté dans le noir, la police les contrôle, les maraudeurs repartent, la police les re-contrôle, les maraudeurs accélèrent car ils ont cru voir des formes humaines au loin, la police accélère, les maraudeurs s’arrêtent, la police aussi et re-re-contrôle. Et rebelote. Et c’est ainsi jusqu’au milieu de la nuit.
Et toute la soirée, j’ai cru entendre la musique d’une fanfare slave tsigane, la musique entêtante des films d’Emir Kusturica. Il y aurait un film émouvant et tragicomique, absurde et mélancolique, à faire pour raconter ce qui se passe dans ce minuscule bout de territoire frontalier.
La raison et l’accueil républicain ont déserté depuis longtemps les soirées d’hiver de Montgenèvre. Ce pourrait être drôle, et l’on rit parfois, il faut l’avouer, parce que le temps est long et que les situations prêtent au rire kafkaïen. Quand vous êtes contrôlé·e·s pour la quatrième fois en deux heures, au même endroit, dans la même voiture, par les mêmes gendarmes, répétant les mêmes gestes et les mêmes paroles, le rire s’installe malgré soi. Ce n’est plus du Kusturica, du Kafka, c’est du Beckett.
Mais le rire cache l’agacement, la tristesse, la colère même. Les bénévoles ont accumulé des milliers d’euros d’amendes en janvier et février. Les exilé·e·s se perdent dans la montagne, tombent et se blessent ou se brûlent les pieds au point de se faire amputer.
Forces de l’ordre et bénévoles sont épuisé·e·s par ce scénario exténuant, qui se répète chaque soir, imposé par le plus haut niveau de l’État, en dépit du bon sens républicain, gestionnaire et humaniste.
Les équipes de gendarmes, comme celles de la police aux frontières, ont été renforcées en masse. Deux pick-ups remplis de sentinelles de l’armée, avec leurs mitraillettes, sont apparus cet hiver. La police italienne fait des allers-retours incessants, en pleine nuit, pour ramener les exilé·e·s attrapé·e·s par la police française et les déposer au refuge créé par La Croix Rouge côté italien, à Oulx, vingt kilomètres en dessous du poste frontière français.
Des personnes exilées qui n’ont rien, qui ne coûteront rien à la société française, dont on sait trop bien combien celle-ci exploitera leur force de travail le moment venu. Des exilé·e·s qui veulent juste traverser le pays pour aller ailleurs car l’Allemagne accueille mieux. Des exilé·e·s qui ne peuvent pas revenir chez eux quoiqu’il arrive. Des exilé·e·s, parfois avec enfants et bébés.
Installée dans la voiture de Médecins du Monde, j’ai vu les voitures de police et de gendarmerie nous suivre à un mètre, constamment. J’ai été contrôlée en trois jours plus souvent que je ne l’avais jamais été sur le territoire français en 43 ans d’existence. Pourtant, il ne fait aucun doute que toutes les catégories de force de l’ordre présentes sur place savent, depuis le vendredi matin, que trois parlementaires sont présent·e·s et que la femme s’appelle Gwendoline. Mais tant pis pour la raison, le simulacre se met en place à chaque fois : carte d’identité, badge de parlementaire, attestation de couvre-feu jusqu’à minuit, deuxième attestation de couvre-feu après minuit.
« Vous faites quoi ? » « Une maraude. » « Ah. Ok. On va juste vérifier vos papiers. »
Ils partent faire des photos de nos papiers dans leur véhicule. Pour moi, qui travaille au Parlement européen sur les questions de surveillance des populations et constate la mise en place de politiques publiques sécuritaires, je suis servie.
Pendant ce temps, aucune vérification, en revanche, des dizaines de camions et voitures qui traversent la frontière. N’y avait-il pas une exigence de test PCR pour entrer sur le territoire français ? J’ai dû me tromper. La priorité de l’État est de vérifier dix fois en un week-end les papiers d’une petite quinzaine de personnes, militant·e·s de Tous Migrants, infirmières de Médecins du Monde, parlementaires et leurs assistantes.
Je connais déjà la situation en partie. Mon amie Lætitia a réalisé un film, Déplacer les Montagnes. L’association « Un toit sur un Plateau », de mon côté des Alpes, aux Petites Roches, est en lien avec le Briançonnais. À Saint-Pancrasse, à Saint-Hilaire-du-Touvet, à Saint-Bernard, nous avons accueilli des demandeuses et des demandeurs d’asile.
Au Parlement européen, je dénonce les pushback aux frontières croates, hongroises, serbes, la mise à mal de l’État de droit et la violence des représentant·e·s de l’État dans les Balkans.
Je ne découvre pas les épreuves subies par les exilé·e·s, je connais la rudesse du climat et des intempéries dans les Alpes. Mais je m’affole en revanche du niveau de perversion que le système étatique français a atteint en matière d’intimidation morale et judiciaire des militant·e·s. Discours et tentatives de criminalisation des associatifs prennent des proportions très inquiétantes chez les forces de l’ordre.
À Briançon, à Montgenèvre, venues de tous les villages alentours, et de plus loin encore en France, des personnes donnent de leur temps et une énergie immense pour éviter que des drames ne se produisent en montagne. Je les ai accompagnées quelques heures dans leur mission, j’ai pu voir comment ils s’organisent au jour le jour, en fonction du nombre de personnes présentes, avec les moyens du bord. J’ai vu leur détermination, leur courage, leur fatigue aussi.
J’ai constaté, lors de ce week-end, ce que je savais déjà, ce que les bénévoles rappellent toujours, ce que nous expérimentons déjà des risques immenses pris en Méditerranée : celles et ceux qui sont poussé·e·s, par le désespoir et la misère, et qui fuient parfois le pire, sont prêt·e·s à braver tous les dangers.
Les États peuvent fermer les frontières, augmenter le nombre d’agents des forces de l’ordre, équiper les hommes d’armes, renforcer les contrôles en prétextant confinement ou couvre-feu, si des femmes et des hommes ont besoin pour survivre de passer la frontière, ils passeront.
Avec les températures négatives et les chutes de neige, avec les risques en montagne, avec la peur, le froid et la faim, avec les refoulements sans ménagements de la police française, ils passeront.
Ils sont refoulés une fois, deux fois, cinq fois. Ils sont blessés, ils sont encore plus fatigués, ils tenteront un chemin plus périlleux encore et plus loin du regard de la police, mais ils passeront encore. Un jour, ils seront passés. La police aux frontières le sait, les agents ne sont pas dupes, mais ils retardent le passage de quelques jours ou quelques semaines.
Les habitant·e·s du Briançonnais, de la vallée ou des territoires de montagne autour, ne supportent pas l’idée que l’on puisse mourir dans leurs montagnes. D’autres viennent de loin pour donner un coup de main. Ils se relaient, chaque nuit, depuis des années, depuis 2017, notamment l’hiver, pour marauder en montagne, sur les chemins ou les passages difficiles qui traversent d’Italie vers la France.
Ils espèrent chaque soir ne pas avoir raté une ombre ou un bruit, quelqu’un qu’il aurait fallu aider. Quand ils rentrent en milieu de nuit, entre 1 heure et 3 heures du matin, l’angoisse est parfois terrible. Et s’il restait quelqu’un là-haut ? Et si, dans le noir, quelqu’un se débattait noyé·e dans la neige, glissé·e dans un trou, empêché·e par une mauvaise chute ? À plusieurs reprises, des corps ont été retrouvés trop tard, parfois seulement après la fonte des neiges.
Les maraudeuses et maraudeurs ne savent pas combien de personnes auront tenté le passage, qui sont ces personnes, d’où elles viennent et pourquoi. Mais tou·te·s savent pourquoi elles et ils sont là. Pour ne pas perdre une part de leur propre humanité en détournant le regard. Même s’il faut passer des soirées et des week-ends à arpenter la neige, à subir des contrôles répétitifs et abusifs des forces de l’ordre, à recevoir en rafale, des amendes pour des motifs étonnants, jusqu’à risquer de passer devant la justice.

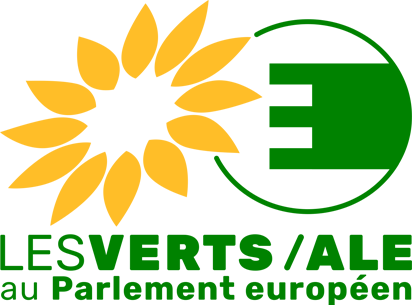

Les commentaires sont fermés.