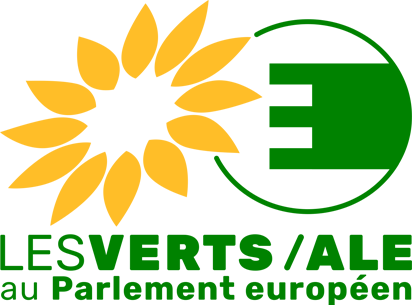Il y a un an Fukushima
Il y a bien sûr le revers de crédibilité que lui a infligé Fukushima sur le terrain ultra-décisif de la sécurité. En prenant connaissance des tourments de la société japonaise, après ceux de l’Ukraine, les populations sont devenues encore plus exigeantes d’un risque zéro que nul ne peut satisfaire. La confiance béate dans l’infaillibilité des ingénieurs s’est effondrée définitivement, car le Japon était une référence absolue en la matière. D’ailleurs, face au tremblement de terre, ils l’ont encore démontré : jamais un séisme aussi puissant dans une zone aussi densément peuplée n’a fait aussi peu de victimes, et aussi peu de dégâts. J’ai eu récemment l’occasion de découvrir l’Àquila, ville italienne dévastée en 2009 par un séisme de bien moindre importance qui a causé plusieurs centaines de victimes. La désolation de cette ville déshabitée, dont la quasi-totalité des commerces sont abandonnés, ses immeubles menaçant ruine malgré les échafaudages de consolidation, son centre interdit à toute circulation humaine, fait froid dans le dos. Tokyo, ou d’autres grandes villes du Japon, auraient pu être dans cet état sans la qualité et l’efficacité des ingénieurs japonais qui sont les inventeurs de la science anti-sismique. On ne peut, face à Fukushima comme on a cru pouvoir le faire face à Tchernobyl, incriminer une quelconque incompétence.
Est venu ensuite le temps des comptes. Ceux que la Cour des Comptes vient de rendre publics démontrent que, face aux nouvelles normes de sécurité requises, face à l’évaluation enfin abordée de la réalité des coûts pour le traitement, et pour le stockage ad vitam aeternam des déchets ultimes, et face aux coûts exponentiels du démantèlement des centrales en fin de vie, le kWh nucléaire n’est pas moins cher qu’un kWh éolien.
Est venu enfin le temps de la crédibilité des démarches de sortie du nucléaire. Le premier pays à s’y être résolu, par la force des choses, c’est le Japon. Presque toutes ses centrales nucléaires sont à l’arrêt, et l’économie japonaise reste debout, sans black-out électrique. L’intensité de son programme d’économies d’énergie, et de développement des énergies renouvelables, décidé lors de l’immédiat après-accident, force l’admiration.
En Europe, le chef de file est l’Allemagne qui a arrêté, dès le lendemain de l’accident de Fukushima, le tiers de ses centrales nucléaires, à savoir les plus anciennes. L’industrie nucléaire française a traité avec mépris la décision allemande et promis que l’Allemagne, l’hiver venu, allait être obligée d’importer de France l’électricité que ne produiraient plus les centrales nucléaires mises à l’arrêt. Le verdict est tombé cet hiver, quand, aux températures les plus basses, il a été constaté que c’était l’Allemagne qui vendait à la France des kWh pour lui permettre de passer la pointe de consommation, et non le contraire. L’explication est simple : alors que la France a plongé dans le tout électrique pour écouler son électricité nucléaire, provoquant des phénomènes de consommation de pointe impossibles à maîtriser, l’Allemagne a misé sur les économies d’énergie, avec une baisse des consommations de 27% sur les dix dernières années, en même temps qu’un programme très ambitieux de développement des énergies renouvelables. Car, contrairement à ce qui est colporté par Nicolas Sarkozy, l’Allemagne n’a construit aucune nouvelle centrale au charbon depuis qu’elle a décidé sa sortie du nucléaire.
Dans ce contexte, « tout fout le camp » pour l’industrie nucléaire française. Les marchés à l’exportation s’effondrent les uns après les autres, AREVA publie des comptes en chute libre, tous les projets sont laissés en attente. L’insécurité nucléaire gagne progressivement l’opinion publique française, même si elle reste sous l’emprise d’un lobby surpuissant. Le témoignage à Paris des victimes japonaises, venues soutenir Eva Joly, va contribuer à fragiliser encore plus le « consensus nucléaire » français. C’est le début de la fin.
François ALFONSI