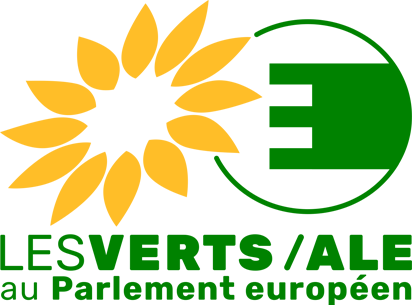Nagoya s’embourbe dans la biopiraterie
Terre 25/10/2010 à 00h00
Reportage
Biodiversité . A la convention de l’ONU, la régulation de la ruée vers les ressources génétiques, qui spolie les pays du Sud, a du mal à s’imposer.
Après la 10e Convention sur la biodiversité (COP 10) qui se tient à Nagoya jusqu’à vendredi, la biopiraterie, à savoir l’appropriation par un acteur privé des ressources génétiques et savoirs traditionnels d’un autre pays – ce «colonialisme privé», selon l’eurodéputée d’Europe Ecologie Sandrine Bélier -, aura encore un bel avenir devant lui. Si le «vol du vivant» est au cœur de négociations très âpres entre les délégations des 193 pays présents, la conférence, point d’orgue d’une année 2010 dédiée à la biodiversité par l’ONU, peine à dégager un consensus.
Alinéa. En témoigne la tension qui règne au centre des congrès de Nagoya. A chaque réunion, des pays émettent leur lot de réserves à l’égard de passages jugés trop engageants, supprimant les alinéas litigieux au risque de faire passer ce rendez-vous aux enjeux faramineux pour le sommet de l’entente cordiale. L’heure est pourtant grave. Partout s’érodent les écosystèmes. Et les demandes pressantes et rétroactives du G77 (de 77 pays défavorisés) à l’égard des Etats riches restent lettre morte. Pour ceux qui planchent sur le plan stratégique des dix ans à venir, attendu en fin de semaine à Nagoya, il y a urgence. «Il faut agir vite mais sans franchir la ligne rouge, prévient Sandrine Bélier. Car légiférer sur la biopiraterie, c’est prendre le risque de la légitimer en partie sur le terrain.»
Les biopirates, eux, ne s’accordent aucun répit. «En Indonésie, les propriétés des herbes et plantes médicinales de nos populations indigènes ont toutes été pillées par des groupes pharmaceutiques étrangers et sans contreparties», tonne Marco Kusumawijaya, fondateur du Centre Rujak pour le développement durable basé à Jakarta. Bruce Dunn, spécialiste environnement à la Banque asiatique de développement (ADB), raconte comment des entrepreneurs occidentaux ont approché les responsables d’un parc national au Vietnam : «Tout sourire, ils leur ont fait part de leur intérêt pour la faune et la flore du parc. On a découvert, après coup, qu’ils l’étudiaient pour le compte d’un géant pharmaceutique.» Au Japon, un autre exemple, pernicieux, illustre l’appât du gain pouvant être tiré de la vie sauvage. «Dans notre pays, un ours noir abattu, cela peut rapporter gros, explique Mika Okuno, responsable de l’ONG Japan Bear & Forest Society. Le prix du foie d’un ours peut grimper à 8 800 euros. Un chasseur japonais a même vendu très cher les reins d’un ours noir en Chine, où leurs vertus sont prisées, à tort.»
«Brevetabilité». Comment lutter contre le pillage des savoirs autochtones par des individus ou sociétés commerciales ? «La biopiraterie est un risque permanent, difficile à juguler, juge Kaoru Ichikawa, du projet nippon Satoyama («l’ère socio-écologique») à Tokyo. Il faut des régulations strictes.» Pour les experts réunis à Nagoya, dont ceux du collectif français Biopiraterie, il faut «fixer des limites à la brevetabilité des projets commerciaux sur les terres d’autrui». Cela suppose une refonte du droit de propriété à l’échelle locale, comme planétaire.