
Retour sur 20 ans d’émergence populiste en Europe
Le 22 novembre dernier, j’étais invité à intervenir dans l’événement qui marquait le 20ème anniversaire de l’association « Sauvons l’Europe ». Cela a été pour moi l’occasion de revenir sur ces vingt dernières années. Pour les comprendre, il faut partir d’un moment fondateur : le référendum sur la Constitution européenne de 2005.
Une fracture que nous n’avons pas su refermer
Le référendum français n’a pas eu seulement comme résultat de rejeter un projet de traité : il a ouvert une fracture que nous n’avons jamais su refermer.
Une fracture entre le projet européen, souvent perçu comme technique et abstrait, et le vécu concret des citoyens, marqué par une insécurité sociale croissante, les délocalisations et un sentiment d’abandon territorial.
À partir de ce moment-là, l’Europe a cessé d’être vue comme un « rempart », une protection pour les Européens et le vide ainsi créé a été rempli par ceux qui prospèrent sur les peurs.
Dès le début des années 2000, le gouvernement de Silvio Berlusconi en Italie avait été le laboratoire d’un mélange de populisme, de démagogie antisystème et d’attaques contre la justice et les contre-pouvoirs, allié à la puissance de son groupe de médias.
Il a été suivi ensuite sur cette voie par Viktor Orbán, les frères Kaczyński, Matteo Salvini… jusqu’à Jordan Bardella qui incarne aujourd’hui en France le même type de stratégie.
Les quatre fautes que nous avons commises
Ce mouvement est le résultat de quatre fautes que nous avons commises collectivement.
- Nous avons tout d’abord sous-estimé l’ampleur des humiliations subies.
Pendant que l’Europe s’élargissait, que la mondialisation s’accélérait, des millions de citoyens perdaient confiance dans leur avenir. Et à ce moment-là, ils n’ont pas constaté que l’Europe les protégeait. Ils ont surtout entendu un discours de responsabilisation individuelle : « adaptez-vous », « formez-vous ».
Dans de nombreux territoires, l’Europe n’était plus une promesse d’avenir meilleur, mais synonyme de déclassement.
- Nous avons laissé dériver le marché unique sans contrepoids social.
La logique de concurrence généralisée a certes produit des gagnants mais aussi beaucoup de perdants. Et elle a miné l’idée de solidarité.
Des régions entières ont vu leurs usines partir, leurs médecins disparaître, leurs services publics s’éroder.
Cette dérive a d’abord affaibli les classes populaires, puis les classes moyennes, fondements du contrat démocratique.
- Les États membres ont contribué à décrédibiliser l’Union
Beaucoup de gouvernements se félicitent, à Bruxelles, de décisions qu’ils dénoncent ensuite à Paris, Rome ou Budapest.
Cette duplicité permanente crée un ressentiment profond : l’Europe est devenue le bouc émissaire commode de toutes les lâchetés nationales.
- La gauche culturelle est orpheline et la droite sans boussole.
La droite classique s’est progressivement alignée sur les discours puis sur les politiques de l’extrême droite.
La gauche a été prise dans ses contradictions entre une ouverture au monde qu’elle voulait assumer et la réalité sociale qu’imposait la mondialisation néolibérale.
L’écologie, quant à elle, a servi de bouc émissaire. Parce qu’elle remet en cause des rentes, des modèles agricoles et industriels en place, elle a suscité une violente réaction des puissants de l’ancien monde qui se sont appuyés sur les désordres sociaux créés par la mondialisation libérale pour la dénigrer.
La Commission européenne renie peu à peu l’ambition historique du Green Deal qu’elle avait elle-même initiée et le PPE a acté un compromis historique avec l’extrême droite sur le climat et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Pour la première fois, une majorité politique européenne organise un recul démocratique, écologique et social…
Un contrat social qui n’est plus tenu
L’Europe s’était construite après le fascisme comme un bouclier démocratique, adossé à un contrat social fondé sur la sécurité, l’ascension sociale, l’État-providence.
Ce contrat n’est plus tenu. La société s’est fissurée. Et dans cette fissure, un tiers des citoyens européens sont passés, scrutin après scrutin, de l’euroscepticisme à un rejet global des élites démocratiques.
L’Europe reflète cette crise, mais ne la corrige plus. Elle n’offre plus de récit collectif, plus de projection, plus d’horizon commun.
Les démocraties nationales s’épuisent, les partis traditionnels s’effondrent, la confiance s’effrite. Quand le quotidien se détériore, la démocratie semble devenir un luxe.
Je le vois chaque jour à la présidence de la sous-commission des droits humains : là où l’Europe recule, la barbarie avance.
La fin de l’histoire n’est pas écrite
Voilà ce que nous avons raté. Mais la fin de l’histoire n’est pas écrite : lorsque l’Europe protège, lorsqu’elle assume une vision, elle peut encore redevenir un acteur puissant.
La démocratie n’est jamais acquise. Elle se défend – ou elle disparaît. Aurons-nous le courage de tirer les leçons de nos échecs des vingt dernières années ?
Les dix prochaines années seront décisives avec notamment en 2027 des élections en Allemagne, en Italie, en France et en 2029 de nouvelles élections européennes et en même temps une décennie charnière pour le climat, l’industrie, la géopolitique, les migrations ou encore l’Intelligence artificielle.
La question n’est plus : « comment éviter la victoire des populistes ? », mais « comment éviter que les populistes ne redéfinissent l’Europe de l’intérieur ? »
Nous avons 40 mois devant nous, jusqu’à 2027, pour empêcher ce basculement. 40 mois pour reconstruire un projet européen qui donne envie d’y croire.
Alors que manque-t-il au projet européen pour redevenir un bouclier démocratique ?
- Il manque de la protection : économique, sociale, environnementale.
- Il manque de la justice : lutter contre les rentes, les abus de concurrence, la dégradation des services publics.
- Il manque du courage politique : dire la vérité sur les transformations nécessaires.
- Il manque un récit : une Europe qui inspire – pas seulement une Europe qui régule.
Les trois chantiers incontournables
Trois chantiers sont incontournables.
1. La refondation du projet industriel et climatique
Nous devons revenir à la logique du rapport Draghi : un véritable projet européen de souveraineté industrielle, d’innovation, de protection écologique et de résilience.
Le Green Deal ne doit pas être abandonné : il doit être doublé d’un pacte industriel puissant, lisible, populaire.
2. Un nouveau contrat social européen
Un marché unique qui écrase les travailleurs et les territoires n’est pas viable.
Nous devons :
- assurer des convergences sociales réelles,
- protéger les secteurs stratégiques,
- faire de la transition écologique un moteur d’emploi et non un facteur de peur.
L’Europe ne survivra pas si elle ne protège plus les classes moyennes.
3. Une réforme institutionnelle courageuse
Oui, nous devons rouvrir la question des traités.
Oui, nous devons envisager un renouvellement anticipé de la Commission si elle renonce à son mandat écologique
Oui, nous devons redonner de la clarté démocratique à notre projet collectif.
L’Europe doit redevenir un acteur : pas un spectateur, encore moins un arbitre passif des colères nationales.
L’Europe a déjà prouvé que lorsqu’elle s’unit, elle peut sauver son agriculture, ses industries, son climat, ses valeurs.
L’Europe peut redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : un rempart, une inspiration, un espoir.
Nous n’avons pas le droit d’échouer face à ceux qui veulent défaire ce que l’Europe a construit
Mounir Satouri

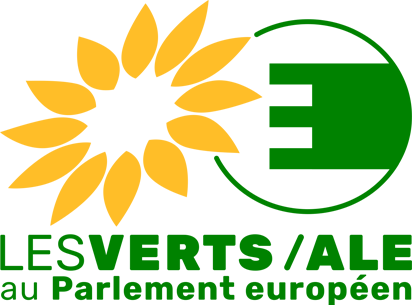
Les commentaires sont fermés.