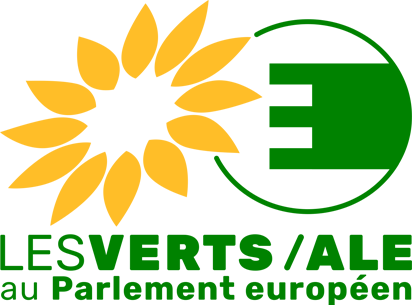Le souhaitable est possible : les quatre pistes de l’écologie politique
Depuis que le keynésianisme a montré ses limites dans un cadre national, la réponse de la gauche social-démocrate a largement consisté, au nom de la nécessaire « modernisation » des économies nationales, en un accompagnement de la mondialisation libérale, plus ou moins honteux ou assumé selon les pays (mise en œuvre de la libéralisation des marchés financiers dans les années 1980, ouverture des services publics à la concurrence en Europe, diminution de la fiscalité sur le capital…). A aucun moment les partis sociaux-démocrates n’ont vraiment commencé à construire un projet alternatif coordonné, y compris au niveau européen. Un gouvernement de gauche a-t-il mis des conditions sociales à l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ? Les gouvernements de gauche ont-ils tiré les conclusions des crises financières à la fin des années 1990 pour proposer une re-réglementation du système financier international ? Les gouvernements européens de gauche, lorsqu’ils étaient majoritaires à la fin des années 1990 (Jospin en France, Blair en Grande-Bretagne, Prodi puis D’Alema en Italie, Schröder en Allemagne…), ont-ils fait des propositions concrètes pour lutter contre le dumping fiscal que pratiquent les Etats au détriment de leur capacité à mener des politiques publiques ?
Faute de propositions coordonnées, les projets nationaux de gauche de défense du modèle social, de réduction des inégalités, de lutte contre la pauvreté sont apparus comme peu crédibles et se sont heurté à la clarté du projet des droites qui, lui, n’exige pas de coordination internationale particulière : adapter les modèles nationaux pour les rendre plus « compétitifs » dans le monde tel qu’il fonctionne. Cela revient, partout, à baisser les impôts des plus fortunés pour éviter l’évasion fiscale, à diminuer l’impôt sur les sociétés pour attirer les investissements, à détricoter l’Etat-providence en laissant une place croissante aux compagnies d’assurances, à réhabiliter la « valeur travail » en renforçant par exemple les sanctions contre les demandeurs d’emploi, à réduire le « coût du travail » pour gagner des parts de marché à l’international, etc.
Deux défis Le premier défi des « forces de progrès » consiste donc à proposer concrètement et ensemble des mesures de régulation et de réglementation de la mondialisation libérale et du capitalisme financier.
Le deuxième défi, au moins aussi important, est de répondre à la crise environnementale devenue incontournable et aux dimensions multiples : changement climatique, fin programmée des énergies fossiles, augmentation des prix alimentaires, conflits pour les ressources en eau, sixième extinction des espèces, etc. Rappelons rapidement, pour les derniers sceptiques, que le climat de la Terre évolue comme jamais dans l’histoire de l’humanité : le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a, dans ses dernières évaluations, augmenté la fourchette haute de l’évolution de la température au XXIe siècle à 6,5 °C, sachant que 6 °C seulement nous séparent de la température moyenne de la dernière ère glacière. Par ailleurs, selon la moyenne des scénarios produits par les compagnies pétrolières et les Etats producteurs, la production de pétrole en 2030 sera équivalente à ce qu’elle est en 2008 alors que l’humanité sera passée de 6,5 à plus de 8 milliards de personnes.
Malgré ses imperfections, l’indicateur de l’empreinte écologique résume bien la situation : nous avons dépassé la capacité de la Terre à assurer le renouvellement des écosystèmes, alors que 1 humain sur 5 vit avec moins de 1,25 dollar par jour et qu’il veut légitimement accéder à davantage de biens matériels. Résoudre ce dilemme de manière négociée et pacifique est sans doute le principal enjeu du XXIe siècle.
La réponse commune à ces deux défis s’appelle le développement soutenable, que l’on peut définir comme la mise sur un même niveau des logiques et enjeux économiques (profit, progrès technique, modes de production, investissement…), sociaux (bien-être, redistribution, réduction des inégalités, participation à la vie sociale, santé…) et environnementaux (biodiversité, climat, eau, pollution de l’air et des sols…).
Cette définition du développement soutenable pose immédiatement la question du capitalisme, et notamment du capitalisme financier. Une position pragmatique nous semble pouvoir éviter deux écueils : considérer que le capitalisme financier et le libéralisme économique mondialisé peuvent être une solution à la crise de la planète. Le rapport Geo 4 (1) du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) montre bien que le scénario le plus libéral est aussi le pire en matière écologique. Inversement, faire du dépassement du capitalisme libéral un préalable à toute solution écologique est le meilleur moyen de se contenter d’un discours incantatoire. Le dépassement du capitalisme ne peut être en effet qu’un processus issu d’un changement culturel et social profond, qui ne concerne pas seulement quelques fonds spéculatifs mais bien l’ensemble des rapports sociaux et de nos aspirations individuelles.
La sortie du capitalisme financier libéral et de la société de consommation sera une conséquence du succès d’un modèle de développement soutenable pour 9 milliards d’êtres humains vivant sur une seule planète. Au sens strict, le développement soutenable constitue d’ailleurs une forme de dépassement du capitalisme financier. En mettant au même niveau les intérêts sociaux, environnementaux et économiques, il va bien au-delà de la prise en compte privilégiée des seuls intérêts des actionnaires. Parallèlement, en exigeant que les intérêts des « générations futures », autrement dit les effets à long terme des comportements actuels, soient pris en compte, il oblige à sortir du court-termisme des résultats financiers trimestriels. Enfin, le développement soutenable offre une sortie de l’« économicisme », qui fait croire que ce qui n’est pas économiquement mesurable n’a pas de valeur, et ouvre la voie à d’autres visions de la richesse, mesurée par d’autres indicateurs que le produit intérieur brut (PIB), l’Ebitda (2) ou le Dow Jones.
Quatre réponses Comment la gauche peut-elle parvenir à relever ce double défi ? Faisons quelques propositions concrètes articulées à une méthode de changement social pour mettre en mouvement nos sociétés. Multiplier les niveaux d’action Premièrement, il est nécessaire de jouer sur tous les leviers de mobilisation, à savoir l’intérêt, le plaisir, les valeurs et l’obligation. Il est illusoire de penser que l’ensemble de la société va spontanément se convertir aux valeurs du développement soutenable et renoncer à l’hyperconsommation pour permettre le développement des pays pauvres et le bien-être des générations futures. Pour autant, rien de durable, ni de démocratique, ne peut se faire sans un changement de nos comportements quotidiens de consommation. Pour l’enclencher à grande échelle, il est donc nécessaire de mettre en place des dispositifs qui rendent rentables financièrement les comportements vertueux, en récompensant par exemple le renoncement à consommer des biens polluants en pouvoir d’acheter des services locaux ou des biens écologiques. On pourrait par exemple imaginer que le fait de ne pas prendre l’avion pendant une certaine période donne droit à une gratification sous la forme d’accès gratuit à un panier de biens et services dont l’impact sur la planète est beaucoup plus faible (biens culturels, services à la personne, produits alimentaires bio ou de proximité, abonnements à des transports en commun ou des systèmes de voitures en libre-service…).
Ce système aurait l’avantage d’être à la fois écologique et redistributif – car les plus pauvres sont aussi, en moyenne, les plus économes en énergie, même si la part de l’énergie dans leur budget est supérieur –, et de développer les budgets affectés qui permettent d’améliorer l’efficacité de la dépense publique en soutenant directement les modes de production jugés souhaitables. A travers ce dispositif, ainsi que bien d’autres encore, il s’agit de proposer une réponse qui lie la nécessaire conversion écologique de notre économie, l’amélioration du pouvoir d’achat des catégories sociales dont le revenu est inférieur au revenu médian, et la création d’emplois non délocalisables. Car toutes les études le corroborent (3) : l’écologie est un des principaux gisements d’emplois du XXIe siècle. Si la France faisait aussi bien que l’Autriche en matière d’agriculture biologique, elle créerait autour de 80 000 emplois nets, mettant ainsi fin à une tendance amorcée au XIXe siècle de diminution de l’emploi dans le secteur primaire. Si la France mettait en place une politique d’isolation des logements à la hauteur des enjeux, elle pourrait créer plus de 100 000 emplois nets pérennes dans le bâtiment et l’artisanat. Jouer sur les différents niveaux territoriaux Deuxièmement, il faut miser sur tous les niveaux territoriaux. Rien ne serait pire que de se réfugier dans le local, en déniant tout caractère démocratique aux lieux de discussion et d’élaboration de normes entre Etats comme l’Organisation mondiale du commerce. C’est bien au niveau de l’OMC que l’Union européenne peut porter la revendication de pouvoir mettre une taxe carbone aux frontières, pour que les Etats qui se dotent d’une contrainte carbone, en signant des traités internationaux comme le futur protocole de Copenhague, qui prendra la suite de celui de Kyoto, puissent taxer à leurs frontières les importations de produits en provenance de pays qui pratiquent le « dumping climatique » (voir plus bas).
Inversement, il est contre-productif d’ironiser sur les actions de terrain issues par exemple de l’économie sociale et solidaire au prétexte qu’elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. Car ces innovations locales ouvrent la voie à d’autres politiques et d’autres relations sociales, à condition que le politique s’en saisisse et définisse les conditions de leur généralisation dans un cadre qui ne soit pas uniquement marchand et capitaliste. La mutualisation non capitaliste de la couverture des risques de santé, l’auto-partage, le vélo en libre-service, les services à la personne, la prise en charge des personnes handicapées…, sont autant d’innovations qui sont nées de et dans l’économie sociale et solidaire.
Enfin, même s’il n’est pas possible de faire du développement soutenable dans un seul pays, il est possible d’y contribuer sans attendre que les grandes négociations internationales débouchent sur de nouvelles politiques en matière de régulation des marchés financiers ou de limitation du changement climatique. Les questions d’urbanisme, de politique des transports, de politique industrielle ou même de politique fiscale, comme le montrent les récentes propositions allemandes pour lutter contre l’exode fiscal au Lichtenstein, peuvent encore être traitées de manière pertinente au niveau national. La responsabilité des politiques nationaux est donc largement engagée.
Pour autant, c’est bien au niveau européen que les capacités d’action sont les plus importantes. Or, la droite libérale et conservatrice a aujourd’hui la majorité politique dans la plupart des Etats membres, ainsi qu’au sein de la Commission européenne et du Parlement européen issu des élections de 2004. C’est dire l’importance des élections européennes de juin prochain pour faire de l’Europe un véritable outil au service d’une politique de développement soutenable. En s’appuyant notamment sur quelques réformes clés (4).
La première peut être la transformation du pacte de stabilité et de croissance en pacte de développement soutenable, qui intégrerait comme objectif contraignant la diminution des émissions de gaz à effet de serre sur un rythme conforme aux exigences du « Facteur 4 » (5), la diminution du taux de pauvreté, la réduction des inégalités, etc. La deuxième réforme est le développement d’une réglementation fondée sur le principe de l’accès qualifié au marché unique. L’Union européenne est le premier marché du monde et aucune multinationale ne peut s’en passer. C’est donc le bon niveau pour élaborer des réglementations limitant l’accès au marché européen sur la base du respect de critères sociaux et environnementaux, comme le respect des conventions de base de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale, le non-travail des enfants, le non-travail forcé, etc., et, sur le plan environnemental, les conventions internationales sur la biodiversité et l’accord international sur le changement climatique qui prendra le relais de Kyoto après 2012. Il ne s’agit pas de protectionnisme, au sens où le respect de ces obligations pèse tout autant sur les producteurs de l’Union que sur ceux qui sont situés en dehors de l’Union, mais d’accès qualifié au marché : les entreprises peuvent produire où elles souhaitent, mais elles ne peuvent pas vendre dans le marché unique si elles ne respectent pas des règles sociales et environnementales internationalement reconnues.
Ce type de réglementation est-il possible dans le cadre actuel de l’OMC ? La réponse est sans doute positive (6), même si cette démarche ne manquera pas de générer des contentieux tant les intérêts économiques et géopolitiques menacés sont puissants. Il est intéressant de constater que la directive Reach adoptée en 2007 par l’Union européenne pour obliger l’industrie chimique à mieux maîtriser la nocivité des substances qu’elle utilise, et qui constitue un très bon exemple d’accès qualifié au marché, n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun recours de la part des multinationales et est aujourd’hui en passe de faire tache d’huile au Japon. Remarquons également que quand l’Organisation mondiale de la santé (OMS) constate l’apparition de la fièvre aphteuse dans un pays, tous les autres pays ont le droit de fermer leur marché à ses exportations (7). Etats, entreprises, individus Troisièmement, il faut s’appuyer simultanément sur les pouvoirs publics, les entreprises et les individus. Si l’un des trois manque à l’appel, le changement social ne peut s’opérer. Ainsi, si les pouvoirs publics mettent en place une véritable politique d’efficacité énergétique, que les individus sont partants, mais que les artisans ne sont pas en nombre suffisant ou bien formés pour isoler les bâtiments et poser de nouveaux équipements, le changement se grippe. Inversement, si des entreprises jouent le jeu des écolabels, des éco-innovations, etc., et sont en capacité de produire en polluant beaucoup moins (comme la voiture à air comprimé, par exemple), mais que les pouvoirs publics freinent ces évolutions (par exemple de peur de perdre des recettes fiscales sur les carburants fossiles), alors c’est le conservatisme qui prévaut. Enfin, même si les entreprises et les pouvoirs publics jouent le jeu du développement soutenable, rien ne peut se faire, dans une démocratie et une économie de marché, sans l’adhésion du plus grand nombre, comme citoyen et comme consommateur.
Dans ce contexte comment mobiliser les entreprises et les amener à passer du modèle actuellement dominant de création de valeur pour l’actionnaire à celui du développement soutenable ? Le premier enjeu est de fixer des objectifs clairs et de s’y tenir. Les entreprises sont capables de changements profonds à partir du moment où le cap est stable et le chemin progressif. Les multinationales sont de véritables paquebots, et on ne peut leur demander de changer du jour au lendemain de modèle économique. Le modèle libéral de la création de valeur pour l’actionnaire a mis trente ans pour s’imposer à partir de la fin des années 1970. Celui du développement soutenable mettra aussi du temps mais peut fonctionner si les entreprises qui ne respectent pas les nouvelles règles du jeu sont sorties progressivement du marché.
Comment faire en sorte que ces nouvelles règles du jeu voient le jour et se généralisent ? En mettant en place les conditions d’un marché responsable dont nous pouvons esquisser quelques pistes. Il s’agit tout d’abord de réformer le code des marchés publics. La commande publique représente autour de 12 % du PIB des économies européennes et jusqu’à 15 % dans les plus riches d’entre elles. Il s’agit donc d’un levier majeur pour orienter les modes de production. Sous l’effet des propositions de la Commission européenne, le droit des marchés publics a évolué dans un sens positif ces dernières années : il y a dix ans, il était ainsi impossible pour un acheteur public de privilégier un produit en vertu de sa meilleure efficacité environnementale. Aujourd’hui, cela est tout à fait légal mais reste du ressort du bon vouloir de la collectivité. La Commission propose maintenant de rendre obligatoire le choix du produit le plus écologique. Cette réforme aurait des conséquences importantes sur de nombreux secteurs pour lesquels la commande publique est un débouché important. Elle ferait porter la concurrence sur la capacité à rendre le meilleur service écologique au meilleur coût et donnerait un coup de fouet aux éco-innovations qui pourrait se propager par la suite à l’ensemble de l’économie. Cette réforme serait à court terme susceptible d’entraîner un surcoût pour les acheteurs publics, car la qualité écologique peut avoir un coût. Mais les collectivités qui se sont déjà engagées dans la voie d’une commande publique ecoresponsable ont acquis le savoir-faire nécessaire pour limiter voire annuler ce surcoût : marchés mieux ajustés aux besoins, économies réalisées dans le temps et qui viennent plus que compenser les dépenses initiales, etc.
Autre levier d’action, la fixation d’objectifs contraignants fondés sur des technologies maîtrisées par les entreprises les plus en pointe. Il pourrait revenir à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) de réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) de tous les produits, en commençant par les plus polluants ou ceux sur lesquels la marge de manœuvre est la plus importante, et de définir de nouvelles normes d’accès au marché fondées sur le respect de l’ACV la plus écologique. Par exemple, trois ans après la définition de l’ACV la plus performante, les produits qui font moins bien ne pourraient plus être commercialisés. Ce système a le double avantage d’orienter la concurrence sur un enjeu utile (réduire l’empreinte écologique globale du produit « du berceau à la tombe »), sans pour autant privilégier tel ou tel procédé technique qui peut produire des effets bénéfiques sur un critère (par exemple les émissions de gaz à effet de serre) mais comporte des effets pervers pour l’environnement sur un autre critère (comme la pollution des eaux).
Levier supplémentaire, l’internalisation des coûts sociaux et environnementaux. Donnons simplement deux exemples. Les entreprises qui ont recours plus que la moyenne de leur branche à de l’intérim, des CDD de courte durée et des contrats à temps très partiel devront s’acquitter de cotisations sociales nettement plus élevées que leurs concurrents qui jouent le jeu de la qualité sociale des contrats de travail et internalisent ainsi de fait un coût social supérieur. En matière environnementale, le fait de donner un prix à la destruction de notre capital naturel au moyen, par exemple, d’une contribution énergie-climat basée à minima sur les émissions de gaz à effet de serre permet de donner le vrai coût de production pour la planète. Selon l’OCDE et les Nations unies, le prix d’une tonne de carbone devrait se situer entre 80 et 100 euros, contre une dizaine d’euros aujourd’hui. Or, une étude de l’Ademe a montré que, à 27 euros la tonne, produire de l’aluminium n’est déjà plus rentable. Ainsi, dès que l’on prend en compte le vrai prix de l’impact de nos modes de vie sur l’environnement, leur caractère insoutenable apparaît. Reste à le traduire dans les prix de marché pour diminuer les consommations des produits les plus nocifs et encourager les technologies les plus efficientes.
D’autres moyens tout aussi importants que les précédents mais qui ne peuvent être développés ici pour des questions de place sont à utiliser. Il s’agit par exemple des contrats de décroissance de l’empreinte écologique qui sont passés entre les pouvoirs publics, les universités et les entreprises pour orienter les innovations technologiques vers la diminution de la pression exercée sur l’environnement, ou de l’élargissement des secteurs économiques couverts par la contrainte carbone et tenus d’acheter des permis d’émissions de CO2, etc.
Maîtriser la finance Enfin, il faut faire le ménage dans la financiarisation excessive de l’économie. Depuis une vingtaine d’années, le processus d’évaluation de la valeur des entreprises par les marchés financiers a pris le pas sur toutes les autres considérations. Le développement des systèmes de fonds de pension, d’assurance-vie, la rente pétrolière et gazière liée à l’augmentation du prix des matières premières, la montée des inégalités qui a permis la (re)constitution de patrimoines colossaux, ont amené sur les marchés financiers des liquidités dans des proportions jamais vues jusqu’alors. Ces liquidités ont donné la possibilité aux fonds de pension, aux fonds spéculatifs et aux fonds souverains de prendre le contrôle des stratégies d’entreprise, en menaçant d’OPA hostile celle qui ne jouerait pas le jeu de la maximisation de la valeur actionnariale. Résultat, les entreprises font tout pour augmenter les dividendes versés aux actionnaires et leur valorisation boursière. Elles rachètent ainsi leurs actions en s’endettant, diminuent leur masse salariale sur la base de seuls critères financiers, utilisent à plein les paradis fiscaux et les outils d’optimisation fiscale pour contribuer le moins possible aux dépenses collectives. Ces mécanismes sont clairement incompatibles avec les exigences du développement soutenable.
Mais il n’y a pas de fatalité. Ces tendances peuvent être inversées si les Etats le veulent, s’ils se saisissent de l’occasion ouverte par la crise des subprimes pour, après trois décennies de libéralisation organisée par les Etats eux-mêmes, re-réglementer la finance internationale, comme le président Roosevelt avait fait le ménage après la crise de 1929. Les pistes de régulation interne à l’industrie financière sont connues : interdire certains produits dérivés qui encouragent l’économie de casino – ainsi, quel est l’intérêt pour l’économie en général des produits dérivés qui misent sur l’évolution des indices boursiers ? Obliger les banques à mieux maîtriser leurs risques pour éviter les prises de position les plus spéculatives. Encadrer le rôle des agences de notation financière pour sortir des conflits d’intérêt. Limiter les capacités d’OPA hostile pour diminuer la pression de rachat boursier qui pèse sur les entreprises. S’attaquer aux paradis fiscaux pour éviter l’opacité des flux financiers, etc.
Mais ces régulations ne doivent pas cacher d’autres enjeux qui se situent en dehors des outils financiers eux-mêmes et de leurs dérives. L’enjeu principal est peut-être de mettre en relation les liquidités abondantes qui circulent sur les marchés et les besoins d’investissement colossaux pour réussir la conversion écologique de l’économie et inventer une économie sans pétrole.
Différentes études d’opinion, lors des élections présidentielles françaises de 2007, ont montré que les aspirations majoritaires relevaient plutôt de valeurs de gauche – solidarité, protection, égalité des chances… –, mais que la majorité de ceux pour qui ces valeurs étaient centrales ne pensaient pas la gauche capable de les mener à bien, en raison de la mondialisation notamment. C’est donc bien cette bataille du possible que la gauche doit à nouveau gagner. Elle doit certes s’appuyer sur l’échelon local (régions, villes…), où le souhaitable est resté perçu comme possible, ce qui explique en partie la capacité de la gauche et des écologistes à gagner les élections locales. Mais elle doit aussi être menée sur les terrains national, européen et international.
D’où l’importance de prendre des initiatives transnationales communes sur la base d’un travail et de propositions partagées, pour montrer que la mise en œuvre d’une politique de développement soutenable est possible, brique après brique, au niveau international. C’est un nouveau chemin que nous devons inventer, celui qui nous permettra d’éviter la régression : régression démographique par la multiplication des conflits, régression du bien-être par la diminution subie et rapide des biens matériels, régression des solidarités par le recentrage de chaque pays sur ses intérêts nationaux dans un contexte de rareté globale des ressources, et au sein de chaque pays régression sur la défense des seuls intérêts individuels au détriment du vivre ensemble. C’est le défi que les écologistes sont prêts à relever et qui fonde leur engagement.
NOTES (1) www.unep.org/geo/geo4/report…
(2) L’Ebitda ou « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le « revenu avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions ». Il met en évidence le profit engendré par l’activité indépendamment des conditions de son financement (les charges financières), des contraintes fiscales (impôts et taxes), du renouvellement de l’outil d’exploitation (amortissements) et des risques (provisions).
(3) Pour une synthèse de ces études, voir Eva Sas, « La conversion écologique de l’économie : quel impact sur l’emploi ? », in « Peut-on faire l’économie de l’environnement ? », Cosmopolitiques, no 13, 2006.
(4) Pour en savoir plus sur les propositions économiques des Verts au niveau européen, voir « Une vision verte de l’économie pour l’Europe », texte adopté en avril 2008 par le Parti vert européen (téléchargeable en anglais et en français sur http://economie-social.lesverts.fr).
(5) C’est-à-dire l’engagement pris par la France en 2003 de « diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d’ici 2050 ».
(6) Pour un argumentaire synthétique, voir la Note de veille no 104 du Centre d’analyse stratégique de juin 2008 : Régulation climatique globale : quels mécanismes d’inclusion des importateurs de carbone en Europe ? (http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pd…).
(7) Voir Alain Lipietz, « Ecologie politique et mondialisation », L’Economie politique, no 34, avril 2007.