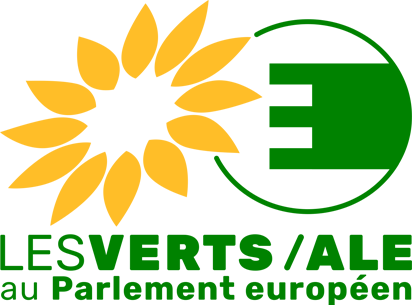L’économie verte, une chance pour l’Europe
Premièrement, l’économie verte contribue à réduire notre dépendance au pétrole et au gaz. Alors que nous sommes en bas de cycle économique, le prix du baril de pétrole est déjà historiquement élevé, autour de 60/70 dollars. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la reprise pourrait conduire à une augmentation rapide du prix du baril le ramenant dès 2010/2011 vers les sommets atteints en 2007/2008, ce qui pèserait immédiatement sur la croissance du PIB. Par ailleurs, l’augmentation du prix du pétrole va creuser nos déficits commerciaux. En 2008, pour la France, le déficit lié aux seules matières premières énergétiques s’élevait à 59 milliards d’euros soit plus que le montant du déficit total de la balance commerciale (56 milliards). De plus, l’argent de la rente pétrolière et gazière est utilisé par les pays producteurs pour financer leurs investissements domestiques, mais aussi, voire surtout, pour acheter des actions des entreprises des pays du Nord via leurs fonds souverains. Ceux-ci représentent déjà plus de 3 000 milliards de dollars et leur capital pourrait s’élever à 10 000 milliards de dollars en 2015 selon la banque d’affaires Morgan Stanley. Investir massivement dans les économies d’énergie et les énergies renouvelables est donc un bon moyen pour « garder l’argent à la maison » et limiter notre dépendance géopolitique.
Le deuxième grand intérêt de l’économie verte pour l’Europe est son potentiel de création d’emplois. Selon une étude menée pour la Confédération européenne des syndicats en 2007, le fait de diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 contribuera à créer plus d’emplois nets (emplois créés-emplois détruits) que le fait de suivre simplement les tendances actuelles. Pourquoi ? Essentiellement pour deux raisons. Tout d’abord l’intensité en emplois européens des secteurs qui se développeront dans le cadre de la conversion écologique de notre économie (comme l’isolation des bâtiments, les énergies renouvelables, les transports en commun…) est supérieure à celle des branches dont l’activité va diminuer, comme l’importation de pétrole ou la fabrication d’automobiles individuelles. En France, par exemple, 1 million d’euros de chiffre d’affaires dans l’isolation des bâtiments génère 16 emplois dans l’hexagone, quand le même million d’euros dépensé dans le raffinage du pétrole ne crée que 3 emplois (source Insee). Deuxièmement, l’augmentation prévi¬sible du prix du pétrole va ponctionner le pouvoir d’achat des ménages, comme ce fut le cas au premier semestre 2008, réduisant leur consommation d’autres produits que l’énergie. Or comme l’énergie importée est l’une des dépenses les moins créatrices d’emplois dans l’économie européenne, dépenser plus pour le carburant de son véhicule et aller moins au restaurant revient à diminuer le contenu en emplois de notre consommation et donc à créer du chômage.
Troisième intérêt de l’économie verte pour l’Europe, la capacité de conserver une valeur ajoutée pour son industrie. L’Europe ne gagnera pas la bataille des prix avec les grands pays émergents dont la Chine. La seule chance pour l’industrie européenne de rester compétitive est donc de se battre sur la qualité et l’innovation. Les écotechnologies et des normes strictes de qualité environnementale sont un moyen de faire porter la concurrence sur d’autres facteurs que le prix. Tous les produits verts dont nous aurons besoin demain ne seront bien sur pas produits en Europe – la Chine vient de détrôner l’Allemagne comme premier producteur mondial de panneaux solaires dont 95 % sont exportés- mais sans ces innovations vertes, l’avenir de l’industrie européenne sera sans doute encore plus noir.
Même si l’on est convaincu de l’intérêt de cette conversion pour l’économie européenne, peut-on réellement l’engager si les autres grandes forces économiques ne le font pas ou le font plus lentement et plus timidement que nous ? Si l’on s’en tient au changement climatique et à la réduction de nos émissions de Co2, le cas le plus complexe porte sur le secteur industriel, même si, paradoxalement, c’est sur lui que porte l’essentiel des normes européennes au travers notamment du marché d’échanges de quotas. Il est en effet difficilement envisageable de faire supporter une contrainte carbone aux industries européens fortement ouvertes au marché mondial si ses concurrents chinois ou américains ne sont pas logés à la même enseigne. Deux solutions sont alors possibles : réduire la contrainte pesant sur les industries européennes ou augmenter celles qui pèsent sur les industries non européennes. Pour le moment, l’Union européenne a choisi la première voie. Le paquet énergie climat adopté en décembre 2008 prévoit en effet que les industries les plus mondialisées, dont la liste doit être établie par la commission à la mi 2010, se verront octroyer jusqu’à 100% de leurs droits à polluer gratuitement jusqu’en 2020 contrairement aux autres industries qui commenceront à payer progressivement leur droit à émettre du Co2 à partir de 2013.. Mais la paquet énergie climat prévoit également, en cas d’échec au sommet de Copenhague, d’étudier la mise en place d’un dispositif d’ajustement aux frontières du marché européen. L’objectif est de taxer les produits en fonction de leur contenu carbone au même niveau de prix que celui supporté par les producteurs européens. La France et l’Allemagne soutiennent cette disposition que la direction générale du commerce international de la commission européenne ne juge pas contraire aux règles de l’OMC. Cette taxe carbone aux frontières pose bien sur de nombreux problèmes : faut il taxer les importations américaines et chinoises au même niveau ? Comment évaluer précisément le contenu carbone du produit importé ? Quelle part de l’argent collecté faut il garder en Europe et quelle part doit être rendue pour financer les investissements verts ?… Des questions complexes auxquelles l’Union européenne n’a pour le moment apporté aucun élément de réponse mais qui seront certainement sur l’agenda européen dans les prochains mois.
Le deuxième outil juridique que l’Union européenne peut utiliser pour avancer plus vite que les autres sans en souffrir dans la concurrence internationale est le principe d’équivalence. Il s’agit d’obliger les entreprises qui produisent en dehors de l’Union à respecter le droit qui pèse sur celles qui produisent au sein de l’Union. Ce principe organise ce que les économistes appellent un accès qualifié au marché. Il permet de tirer la mondialisation vers le haut : à partir de sa souveraineté juridique et en s’appuyant sur le fait que l’union est le premier marché du monde et donc qu’aucune entreprise ne peut s’en passer, l’Europe édicte des règles qui sont ensuite susceptibles de s’appliquer dans le monde entier. C’est une pratique courante en matière de santé publique, de normes de sécurité, etc. La question de savoir si ce principe peut, juridiquement, s’appliquer dans le champ de la lutte contre le changement climatique est encore en discussion mais aucune décision ne démontre pour l’instant le contraire.
Ces débats sur la concurrence internationale ne doivent pas masquer le fait que les productions génératrices de l’essentiel de nos émissions de gaz à effet de serre ne sont pas exposées à la concurrence internationale. Nos bâtiments sont responsables de 36 % de nos émissions de Co2, les transports routiers au sein de l’UE de 21 %, et l »agriculture de 10%, un secteur où seul un cinquième de la production relève du marché mondial. L’essentiel de notre capacité à diminuer nos émissions de GES et notre dépendance au pétrole est donc bien entre nos mains. Malheureusement les textes actuels restent en deçà de qu’il est nécessaire de faire selon les préconisations des scientifiques du GIEC. Parmi les objectifs fixés par le paquet énergie climat il y a l’augmentation de 20 % de notre efficacité énergétique. Cet objectif n’est malheureusement qu’indicatif et non assorti de sanctions pour les pays qui ne le respecteraient pas. Il ne peut donc être atteint que via d’autres textes qui, secteur par secteur, vont fixer des normes contraignantes. C’est justement l’objectif d’un texte actuellement en cours de discussion au Parlement européen sur l’efficacité énergétique des bâtiments, qui représentent 40 % de la consommation finale d’énergie de l’UE. Il s’agit de réviser la directive adoptée en 2002 pour y introduire un règlement plus sévère. La bataille fait rage entre le parlement qui a adopté en première lecture en mai dernier des objectifs ambitieux et le conseil où les Etats veulent à tout prix modérer les contraintes, en contradiction avec les engagements pris dans le cadre du paquet énergie climat. Le parlement a par exemple voté le fait que tous les nouveaux bâtiments (maisons, bâtiments publics, bureaux…) devront consommer zéro énergie nette à partir du 31 décembre 2018, c’est à dire qu’ils devront produire autant d’énergie qu’ils en consomment. Le conseil propose de son côté que les Etats fixent les seuils qu’ils souhaitent. Même chose en ce qui concerne la réhabilitation des bâtiments existants où la proposition du conseil, qui devrait être adoptée fin 2009, est moins ambitieuse que celle votée par le Parlement. Derrière les grands discours des gouvernements, et même en l’absence de risque de désavantage compétitif sur le marché mondial, les actes sont donc encore à la traine. La révolution écologique est en marche mais elle a encore beaucoup d’adversaires…
Economie verte ou croissance verte ?
Trois éléments-clés différencient l’économie verte prônée par les écologistes, de la croissance verte. Tout d’abord, les tenants de la croissance verte soutiennent les mutations écologiques pour autant qu’elles contribuent positivement à la croissance du PIB et permettent aux entreprises de réaliser des profits (capitalisme vert). A l’inverse les écologistes entendent soumettre la réalisation de profits à l’impératif de réduction de l’empreinte écologique : réduire la pression que l’on exerce sur l’environnement peut (voire doit) faire gagner de l’argent aux entreprises qui y contribuent grâce aux biens et aux services qu’elles commercialisent, mais cela peut aussi en faire perdre à d’autres et ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas mettre en oeuvre les politiques publiques nécessaires. L’impact de ces politiques sur le PIB est incertain et dans ce contexte l’augmentation du PIB n’est pas, pour les écologistes, un objectif en soi (le contraire non plus d’ailleurs…). Deuxième différence, les tenants de la croissance verte raisonnent par unité produite quand les écologistes raisonnent en valeur absolue. Les premiers prônent des voitures plus sobres, des avions plus économes, des climatiseurs plus efficaces, etc. Mais ils ne disent rien sur l’effet rebond : si chaque voyage en avion émet un tiers de Co2 en moins grâce au progrès technique mais que le nombre de voyages en avion double sur la même période, les émissions totales de Co2 continuent à augmenter. Les écologistes sont bien entendu favorable à ce progrès technique mais ils souhaitent l’adoption de politiques qui limite la pression totale que l’on exerce sur l’environnement. Dernière différence essentielle, les discours sur la croissance verte ne disent rien sur les inégalités et sur la répartition des richesses puisqu’il s’agit « simplement » de changer les techniques de production. Pour les écologistes, la réduction de l’empreinte écologique totale passe nécessairement par une réduction importante des inégalités, au sein de chaque pays et entre le Nord et le Sud, car plus une société est égalitaire moins son économie doit croitre (et donc polluer) pour augmenter le pouvoir d’achat des plus pauvres.